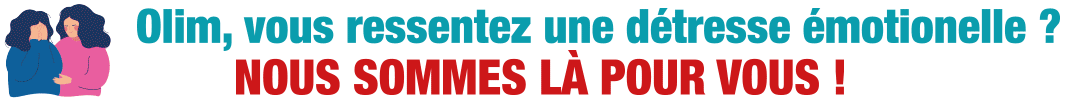« Lorsque vous viendrez dans le pays de Canaan que Je vous donne comme possession, Je mettrai une plaie lépreuse dans les murs d’une maison [1]… »
Dans la paracha Tazri‘a ainsi qu’au début de notre paracha, la Thora parle longuement des différentes tzara‘at, maladies qui ressemblent à la lèpre et atteignent les hommes. Selon la tradition, ces maladies étaient une punition envoyée par Dieu aux hommes qui s’étaient rendus coupables de médisance. Ici, il est question de maisons malades. Pour quelles fautes commises par les hommes Dieu rend-il malades leurs demeures ?
Nos Sages[2] répondent que c’est pour punir de l’avarice. Celui qui se refuse à prêter ses biens, qui prétend toujours ne rien posséder qui puisse être partagé, devra finalement sortir tous ses biens et les exposer au regard de ses voisins. En effet, pour que les objets de la maison ne deviennent pas impurs, le propriétaire doit les sortir :
« Le cohen ordonnera de débarrasser la maison de ce qu’elle contient avant qu’il ne vienne examiner la plaie, afin qu’il ne rende pas impur tout ce que la maison contient[3]. »
Cette plaie vient donc apprendre à l’homme à se détacher de ses biens matériels, détachement nécessaire pour développer les qualités de générosité. Pourtant, une michna de Negaïm propose un regard bien plus positif sur les objets. Cette michna s’interroge sur la raison pour laquelle le cohen doit ordonner de débarrasser la maison de ses objets. Juridiquement, cette action ne semble pas nécessaire, car même si le cohen rendait impure la maison et ce qu’elle contient, cela ne porterait pas à conséquence : en effet, il est toujours possible de purifier les objets en les trempant dans un miqvé (bain rituel).
Aussi, conclut-elle, cette injonction n’est nécessaire que pour les objets en terre cuite qui, eux, ne peuvent pas redevenir purs, un verset enseignant que les objets d’argile rendus impurs doivent être brisés. Ces objets étaient en général de menus récipients de très peu de valeur. La Michna en tire une leçon[4] :
Quels sont les objets que la Thora a voulu épargner : ce sont des cruches et de menus récipients en argile. Si la Thora veut épargner ainsi des biens de petite valeur, à plus forte raison elle donne de l’importance aux objets auxquels l’homme est attaché. Si elle protège ainsi les biens matériels de l’homme, à plus forte raison tient- elle à la vie de ses fils et de ses filles. Si elle agit ainsi envers les biens d’un méchant (un avare !), à plus forte raison est- elle vigilante pour les biens d’un juste.
Quel paradoxe ! Du même verset, on apprend la gravité de l’avarice et le grand prix qu’il faut attacher aux objets matériels les plus quelconques ! La Thora exige qu’on sorte les biens de l’avare à la fois pour le punir de son égoïsme et pour lui éviter de les perdre !
La Thora enseigne ici qu’un lien profond lie l’homme à ses choses et elle reconnaît une valeur à ce lien. Un homme ne peut vivre sans être entouré d’objets. Sans eux il est comme un être dépouillé et nu. Sans le pouvoir de manipuler les choses, il ne peut porter son empreinte sur rien.
Aussi, la marque d’un homme dans ce monde se trouve-t-elle justement dans sa faculté de donner des formes. Par exemple, il donne vie à son intérieur grâce aux meubles et à tous les menus objets qui font sa vie quotidienne, qu’il choisit avec soin et place avec goût.
C’est ainsi que le juste, plus encore que le méchant, est lié aux objets, car la vie du juste est intense. Il est un juste précisément parce qu’il rayonne et influe sur tout ce qui l’entoure. L’avare, en revanche, ne sait pas saisir la dimension cachée qui se dissimule derrière les formes. Il jouit et consomme, les choses n’ont d’importance que par rapport à lui-même et à la satisfaction de ses besoins. Ce qui l’entoure n’existe pour lui qu’en tant qu’excroissance de sa propre personne. L’amener à sortir ses objets de sa maison est bien plus qu’une punition. C’est lui donner l’occasion de se réhabiliter. Il livre ses objets aux regards des autres. Il prend ainsi conscience que tout comme l’homme ne peut vivre sans objets, il ne peut exister sans proches, amis et camarades avec qui il puisse communiquer. En livrant aux autres ce qu’il essayait de dissimuler, il quitte sa solitude et rencontre autrui. Paradoxalement, c’est en donnant de l’importance aux objets, c’est-à-dire un sens, qu’il s’ouvre à la générosité.
Nous pouvons ainsi comprendre un passage difficiles de la Genèse[5] : « Jacob resta seul », dit le Texte, et Rachi comprend qu’il a quitté les siens pour chercher des petites fioles qu’il avait oubliées ! Jacob n’était pas cupide, mais il considérait chacun de ses biens comme un cadeau de Dieu. Il utilisait tout ce qu’il avait pour servir le Tout-Puissant. Il ramenait les objets, création de l’homme, vers leur véritable Créateur. Il ne pouvait donc pas se permettre d’oublier ses fioles.
De même, nos ancêtres, lorsqu’ils quittèrent l’Égypte, eurent l’obligation d’« emprunter » les objets de leurs voisins les Égyptiens. Le texte témoigne[6] : « Ils dépouillèrent l’Égypte » comme Dieu le leur avait demandé. L’Égypte avait transformé les Hébreux en choses. Les hommes étaient devenus des esclaves qui n’avaient de l’importance qu’au travers de leurs capacités de production. Si les Égyptiens avaient ravalé les hommes au rang d’objets, le devoir des Hébreux serait de personnifier les objets.
Ils sauraient être à la hauteur de leur tâche : c’est grâce à leurs dons que le Michkan serait construit.
[1] Lévitique xiv, 34.
[2] Arakhin 16a.
[3] Ibid., 36. En effet, une fois que le cohen avait déclaré la maison impure, tout ce qu’elle contenait le devenait également.
[4] Négaïm, chap. 12, michna 8.
[5] Beréchit xxxii, 25.
[6] Exode iii, 21-22.
Extrait de l’ouvrage ”A la Table de Shabbat”, Par le Rav Shaoul David Botschko